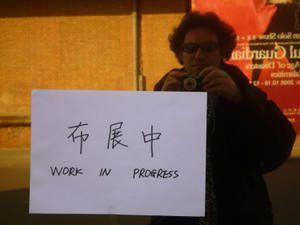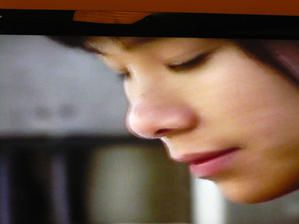J’ai quitté quatre jours la capitale pour accompagner Marc, de l’École française d’Extrême-Orient, qui voulait assister à l’ouverture d’un temple dans un village et rencontrer des prêtres, et David, sujet britannique, venu filmer l’évènement.
Cela se passait dans le sud-ouest du pays, au Jiangxi. (En continuant plus bas, on arrive à Hong Kong.) Nous avons pris le train de nuit de Pékin à Nanchang, le chef-lieu de la province (douze heures de voyage), puis un taxi jusqu’à Tonggu (quatre autres heures), petite ville à la frontière du Hunan, où nous avons passé trois nuits dans un hôtel nouvellement construit, donc très confortable. Le village, Xixiong, situé à quelques kilomètres de Tonggu, est niché au coeur d’une vallée où personne ne se rend jamais et où l’eau courante n’est toujours pas installée.
Les villes traversées avaient en commun une laideur assez effrayante, les maisons longeant les axes routiers étant systématiquement refaites à neuf et de la pire des manières. En revanche, dès que l’on sort des grandes voies, on trouve une architecture qui garde ses caractères originaux. C’est traditionnel, tout à fait digne, le matériau servant à la construction est disponible sur place (les briques et le pisé ont la couleur rouge du sol), le bâti est en harmonie avec le paysage qui l’environne. Bref, les grandes artères sont laides et les campagnes rustiques.
Il est difficile de résumer toutes les rencontres, de dire tous les sentiments ; la plupart des gens que nous avons croisés voyaient des étrangers pour la première fois ou presque, ils ne les « connaissent » que par le biais de la télévision. Dans les rues de Tonggu, nous aurions pu porter des antennes sur la tête et des ailes dans le dos que l’on ne nous aurait pas regardé différemment.
Dans le village de Xixiong, si la réaction a été identique au départ, les gens ont eu ensuite tout le temps de la cérémonie (de huit heures du matin à onze heures et demie du soir) pour s’habituer à nous. Mais, je ne suis pas près d’oublier ce paysan qui s’est littéralement esclaffé en m’apercevant aux premières heures du jour et avait du mal à répondre à mon bonjour tant il riait.
À huit heures du matin, il y a eu un premier repas copieusement arrosé d’alcool fort. Une heure et demie après, première pause dans le rituel et second repas, il y en aura cinq dans la journée, toujours arrosé à l’alcool. Je me suis donc très vite rendu compte que si je ne faisais pas semblant de boire, j’allais finir à quatre pattes dans une rizière.
Les repas et les banquets ont tenu une grande place dans ce séjour. La présence d’étrangers dans ces contrées physiquement coupées du monde (mais ils possèdent des portables en pleine campagne) est un évènement qu’il faut dignement fêter. En tant que spécialiste de la religion en Chine, Marc était, qui plus est, une importante caution pour cette communauté religieuse (attachée à un culte ayant beaucoup en commun avec les taoïstes) jamais à l’abri d’une interdiction pure et simple pour superstition. (Il faudrait dire l’ambivalence des autorités du pays vis-à-vis de la religion : il arrive qu’elle soit soutenue, par intérêt touristique, par exemple.) Cette caution était double : elle valait aussi pour les autorités locales qui doivent toujours se justifier auprès d’un supérieur quelconque.
Il y a un principe qui veut que l’on doit faire énormément boire les invités pour que la fête soit complète. Il vaut mieux s’y préparer car le danger guette les gens comme moi, peu au fait des coutumes locales, à l’inverse de Marc qui a une expérience de plusieurs décennies en la matière. (Je ne parle pas de la boisson, mais de la Chine.) Il y a des compétitions ridicules : à qui boira le plus, videra le plus vite son verre, toute cette pâle virilité dont je n’ai que trop fait le tour ; des toasts scandent les repas. Il y a force cris, les convives se lèvent et hurlent, on s’attendrait à un pugilat, mais non : c’est pour ajouter quelques gouttes à un verre déjà plein.
On a toujours bien mangé, mieux encore à la campagne qu’en ville puisque les produits sont frais et biologiques – à Xixiong, l’emploi des engrais chimiques est interdit sous peine de lourdes amendes. Et ce n’était pas si épicé que cela, ce que nous craignions, mon estomac, mon Dieulafoy (la malformation qui a failli m’emporter l’hiver dernier) et moi. Je distingue ce que l’on a mangé à Xixiong, qui était très simple, du reste, ressemblant plus à ce que l’on peut trouver à Pékin. Le riz a été la seule source de déception, il n’était pas très bon.
En parlant de riz, je dois préciser que la cérémonie coïncidait avec la fin de la seconde et dernière récolte de l’année, elle avait donc une tournure particulière, c’était aussi une fête de village, comme il en existe plusieurs fois l’an. Comme la tradition l’exige, on a tué le cochon, ce qui nous a valu un plat absolument délicieux de boudin frais mêlé à du tofu. En une autre occasion, nous avons mangé du chien. C’est très bon. Le lendemain, croisant un chiot, David a lancé un « Breakfast ! » très swiftien.
Le fait qu’ils finissent par être mangé explique le rapport des paysans à leurs chiens, qui est le contraire de l’affection que l’on constate à Pékin, et s’apparente à de l’indifférence, comme on en conçoit pour une poule, un buffle ou un électeur. D’ailleurs, physiquement, les chiens ressemblent à des chiens errants, ils ont la peau sur les os et on les croirait dépourvus d’attache.
Que dire de la cérémonie en elle-même ? J’avais feuilleté ce qu’en dit Patrice Fava dans un livre à paraître, je savais que c’était extrêmement codifié. Seule la durée n’est pas inscrite : le temps est flottant, il est affaire de circonstance.
Ce qui m’a plu, c’est l’espèce de liberté qui régnait, les gens allaient et venaient, disparaissaient puis revenaient, s’approchaient des officiants, se penchaient sur les textes qu’ils récitaient, sans se soucier des convenances. Il faut croire qu’il n’y en avait point. Rien de compassé donc, ce n’est pas l’Église catholique. Il y a un point important à souligner pour comprendre cela, le temple a réouvert pour les paysans (après sa fermeture sous la révo. cul.), c’est, littéralement, le leur ; ils en ont la charge, se doivent de l’entretenir eux-mêmes. Il n’y a pas de clergé pour cela.
Les officiants au nombre de quatre n’étaient pas assez nombreux pour animer l’ensemble de la partie musicale qui est double, à l’intérieur et à l’extérieur du temple, ce sont les villageois qui ont apporté leur concours pour compléter la formation. Les instruments, sauf un hautbois, étaient des percussions, et bien qu’incapable de marquer le rythme, je sentais bien que ce que j’entendais était assez flottant, comme le temps.
Tout le village s’est rendu au temple, à l’exception de quelques irréductibles matérialistes, dont j’aurais pu faire partie, en d’autres circonstances. (Pendant des années, j’ai refusé de mettre les pieds dans une église, même en Italie.) D’ailleurs, au moment de décider de la somme à offrir comme donation au temple, je réponds sous forme de boutade, « C’est contraire à tous mes principes. »
L’air était chargé des fumées de pétards et de l’odeur lourde de l’encens.
David filmait, Marc observait et discutait, je prenais des notes. David a eu beaucoup de succès avec sa caméra DV : dans les premières heures, il avait en permanence une demi-douzaine de curieux agglutinés à ses côtés. Sans rivaliser avec lui, j’ai eu aussi le droit à de la visite, on venait voir comment je formais les lettres dans mon cahier.
Avec l’alcool, les cigarettes sont un autre moyen de sociabilité. On en offre comme on distribue des poignées de mains. Il ne s’agit d’ailleurs pas de les refuser, ce serait insultant. Si nous avons pas mal bu, nous avons fumé davantage.
J’aménageais des pauses en me promenant dans les environs, seul ou avec Marc. La campagne était belle, presque alpestre. Il y avait les cultures de riz en terrasse, une végétation très dense en hauteur, des pins en grand nombre. Cette vallée enclavée, entourée de montagnes, qui, jusqu’à il y a deux ans, n’était joignable que par une route en terre, avait un air de paradis perdu. Difficile cependant de partager cette impression avec les autochtones qui retenaient plutôt l’inconfort matériel et puis la furieuse envie de mettre les voiles.
Il faut admettre qu’à Xixiong, l’ennui suinte de partout. Et d’abord du seul bar du village qui ressemble fort à ceux qui existent dans les provinces françaises les plus reculées : mêmes trognes qui fleurent bon la dégénérescence mentale, mêmes piliers de bar à la gestuelle approximative. J’y buvais une bière très légère, qui a un goût de flotte comme je l’aime ; j’y avais la paix, mais jamais bien longtemps. Au bout d’un moment, le lieu devenait une annexe du temple, tout le monde s’y arrêtant pour m’observer puis me proposer des tournées. Il fallait batailler sec pour les repousser.
Vers 17 heures, il y a eu un banquet épique. Une journaliste de la télévision locale, basée à Tonggu, venait d’arriver avec deux amis, croyant trouver du théâtre, des masques et de beaux costumes, ce qui aurait pu être le cas, avec des moyens autres. Elle était d’autant plus déçue que le sujet était politiquement bien trop sensible pour faire l’objet d’un reportage. (Nous étions, du coup, assez soupçonneux sur les motivations réelles de sa venue en ce lieu.) Cette équipe s’est faite inviter au banquet avec nous autres, les autorités locales tenant là une affiche qui ne se reproduirait pas de sitôt. La jeune journaliste avait tout d’une caricature : opportunisme exacerbé, fringues à la mode, charme un peu facile, voire familier. Mais, pour les décideurs du village, quelle aubaine. On sentait chez ces chefaillons la crainte de déplaire, de mal faire.
J’ai souvent l’impression qu’en Chine les gens ne sont ni à l’aise avec l’autorité – et avec quelques excellentes raisons historiques ! – ni avec les étrangers, ce que je comprends moins.
Je n’oublierais pas l’arrivée de la petite journaliste et l’effet dévastateur qu’elle a produit sur la communauté. Il fallait lire sur le visage des villageoises ce mélange d’envie et de haine ; c’était terrible, ces regards.
La salle de réception ou salon d’honneur était aussi l’endroit réservé au karaoké. Étant donné la forme des portes, nous nous trouvions sans aucun doute dans une ancienne étable. Le décor était d’un mauvais goût achevé. Le serveur avait la tête de Peter Lorre et semblait tout droit sorti d’une fête de Breakfast at Tiffany’s et The Party. L’analogie avec les films de Blake Edwards ne s’arrêtait pas au personnage du serveur : on y a beaucoup bu. C’est là que j’ai cru que des convives allaient se battre, alors qu’ils ne faisaient que remplir le verre de leur voisin. Je ne me rappelle pas bien des mets, sinon que le riz était décevant et qu’il était servi directement dans l’auto-cuiseur. En revanche, il y a eu plusieurs tournées d’une boisson assez sucrée et très forte.
C’était un banquet de cadres du parti, ça gueulait et ça toastait sans répit. L’alcool amenait un petit vent de folie. Au bout d’un moment, les hôtes nous ont oubliés, et nous avons pu observer tout cela avec une distance d’entomologistes. Nous avons regagné le cœur du village à pied, en riant, heureux de prendre l’air, encore sous le coup de l’ambiance assez déjantée. Il faisait déjà nuit, on croisait des paysans qui rentraient de la fête, tous avaient une lampe de poche, l’éclairage public étant inexistant. Sans lumière, nous avancions gaiement : j’aime les nuits noires.
Il était difficile de faire face à toutes les invitations. Après celle des responsables locaux, il a fallu supporter l’ancien maire, très chargé après le banquet, et qui avait en quelque sorte arrêté notre programme pour le reste de la soirée et nous l’imposait autoritairement. Nous étions les otages de sa volonté de nous faire plaisir. C’était assez égoïste : il nous voulait pour lui tout seul et jusqu’au bout de la nuit. Prétextant qu’il n’y avait plus de repas de prévu à la cérémonie, il en commande un sans nous en avertir. Nous sommes obligés de rester dans le café, alors que nous voulons bouger. Bien évidemment, il y en avait encore un au temple. J’écume de rage, mécontent d’avoir perdu du temps à refuser des tournées de bière au lieu d’être installé peinard au milieu des paysans. C’est que l’alcool aidant, tout est imposé presque avec violence. Et pour les individualistes que nous sommes, cela tourne à la mauvaise plaisanterie – moi-même, je commence à ressentir l’ivresse accumulée, ce qui n’arrange rien.
Il faut vraiment distinguer les paysans des autorités. Nous mangions aux côtés des officiants et des chefs locaux dans une salle attenante au lieu de la cérémonie alors que les autres restaient dehors.
L’aller a été exténuant. Le trajet en taxi surtout, parce que le conducteur conduisait imprudemment vite et manquait d’écraser tout ce qui se trouvait sur le passage de son véhicule (chiens errants, vieilles femmes), on ne se sentait pas de faire autrement que de tout surveiller. Hors des grandes villes, la circulation en Chine est tout de même assez spéciale : au retour, nous avons croisé un type qui faisait traverser une autoroute à près de cent cinquante canards ! Et il est tout à fait banal de voir des buffles en faire autant.
À l’inverse, le taxi du retour refusait de dépasser les 70 km/h. Les Chinois ne roulent jamais vite, attitude qui me convient tout à fait, mais là le chauffeur était exaspérant. Comme Marc et moi passions notre temps à le critiquer, j’ai fait remarquer à David en arrivant à Nanchang qu’il avait voyagé avec de vrais Français : de purs râleurs. En plus, on s’est aperçu que le conducteur ne voyait rien. Déjà au village, j’avais été frappé d’être en somme le seul à porter une paire de lunettes. Quand on sait que dans certaines régions, 87 % de la population n’accède plus aux soins médicaux les plus élémentaires, chiffre qui est allé en augmentant ces dernières années, on ne sera pas surpris que les gens ne cherchent pas à corriger leur vue.
Je n’oublie pas que lorsque j’ai été hospitalisé à Pékin en décembre dernier, mon admission aux urgences n’a été possible que contre un paiement par avance. On critique le système de santé des États-Unis, enfin surtout Michael Moore, mais la plus grande patrie du « socialisme » au monde ne vaut pas mieux. La France en serait peut-être au même point si les médecins ne prêtaient pas un serment qui les oblige à d’abord porter secours, sous peine de radiation et surtout de poursuites judiciaires.
Il me faut vous parler des trains couchettes et de leur personnel essentiellement féminin. Le Français aura la satisfaction de constater que le respect des horaires est aussi pointu qu’à la SNCF. La comparaison s’arrête là. La taille de la gare de Pékin, comme la longueur du train que nous avons pris et le nombre de gens attachés au service des voyageurs sont sans commune mesure avec ce que l’on connaît. Et puis, il y a encore un wagon-restaurant, un vrai, pas comme ceux des TGV qui ont été pensés pour que les gens ne s’y attardent pas. (Après avoir longtemps dominé le monde par son art de vivre, la France cultive l’inconfort comme une vertu.) À l’aller comme au retour, nous avons évoqué avec nostalgie le trajet entre Paris et Lyon en train qui proposait une table extraordinaire.
Ce qui, en Chine, frappe le quidam venu d’Occident, c’est le goût très répandu des uniformes. La société ferroviaire en donne une bien belle illustration avec son aréopage de jeunes employées habillées en bordeaux. Ceux qui hésitent encore à verser dans le masochisme trouveraient là de quoi sérieusement s’interroger : la chef de rang ou du contrôle porte un uniforme bleu marine, de hautes bottes noires et une casquette d’Obersturmführer, digne des Bienveillantes ou de Portier de nuit ! J’ai donc beaucoup aimé le train chinois, usine à rêves sado-masochistes, et, malgré l’éclairage très cru, au néon, son bar vaut bien celui du Talgo qui mène à Barcelone.
Curieusement, bien que le train fut bondé, il y avait moins d’une quinzaine de personnes pour fréquenter le wagon restaurant dans lequel nous nous sommes précipités. Certes le repas était coûteux au regard des prix habituels, mais on trouvait des cannettes de bière pour 5 yuans seulement, soit 6 ou 7 centimes d’euros. Je ne sais pas si la « Blue ribbon » de fabrication chinoise vaut l’américaine de M. Pabst, mais elle faisait très bien l’affaire pour oublier la tristesse que nous causait le départ.
C’est une autre gueule de bois qui m’a accueilli à Pékin. Sur le quai, je m’aperçois que l’on a volé mon appareil numérique et l’argent que contenait mon portefeuille.