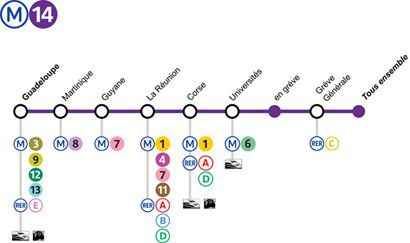« L’autonomie veut dire la mise
au pas des universitaires »
Le Monde du 22 avril 2009
Dans votre dernier livre, Conditions de l’éducation, vous mettiez l’accent sur la crise de la connaissance. Le mouvement actuel dans l’enseignement supérieur n’en est-il pas une illustration ?
L’économie a, d’une certaine manière, dévoré la connaissance. Elle lui a imposé un modèle qui en fait une machine à produire des résultats dans l’indifférence à la compréhension et à l’intelligibilité des phénomènes. Or, même si c’est une de ses fonctions, la connaissance ne peut pas servir uniquement à créer de la richesse. Nous avons besoin d’elle pour nous aider à comprendre notre monde. Si l’université n’est plus du tout en position de proposer un savoir de cet ordre, elle aura échoué. Or, les savoirs de ce type ne se laissent ni commander par des comités de pilotage, ni évaluer par des méthodes quantitatives.
N’est-ce pas pour cela que la question de l’évaluation des savoirs occupe une place centrale dans la crise ?
Alors que les questions posées par les modalités de l’évaluation sont très complexes, puisqu’elles sont inséparables d’une certaine idée de la connaissance, elles ont été réglées de manière expéditive par l’utilisation d’un modèle émanant des sciences dures. Ces grilles d’évaluation sont contestées jusque dans le milieu des sciences dures pour leur caractère très étroit et leurs effets pervers. Mais, hormis ce fait, ce choix soulève une question d’épistémologie fondamentale : toutes les disciplines de l’université entrent-elles dans ce modèle ? Il y a des raisons d’en douter.
Ce n’est pas un hasard si les sciences humaines ont été en pointe dans le mouvement. Il s’agit pour elles de se défendre contre des manières de les juger gravement inadéquates. L’exemple le plus saillant est la place privilégiée accordée aux articles dans des revues à comité de lecture qui dévalue totalement la publication de livres. Or pour les chercheurs des disciplines humanistes, l’objectif principal et le débouché naturel de leur travail est le livre. On est en pleine impasse épistémologique.
Toutefois, la source du malaise est bien en amont des textes de réforme qui cristallisent aujourd’hui les oppositions.
L’université souffre au premier chef de sa mutation démographique. Elle a mal vécu une massification qui s’est faite sous le signe de la compression des coûts et qui s’est traduite par une paupérisation. Il faut bien voir que nous sommes confrontés ici à un mouvement profond, qui relève de l’évolution des âges de la vie, et qui étire la période de formation jusqu’à 25 ans. L’afflux vers l’enseignement supérieur est donc naturel, indépendamment du contenu offert. Étant donné la culture politique française, dans l’imaginaire collectif, l’université devient le prolongement naturel de l’école républicaine gratuite et presque socialement obligatoire. Je ne crois pas plausible de maintenir le modèle de cette école républicaine jusqu’à 25 ans, mais je comprends pourquoi les gens y croient. C’est même constitutif de notre pays. Mais cette spécificité en rencontre une autre, qui joue en sens inverse, à savoir l’existence d’un système à part pour la formation des élites, celui des grandes écoles. Il s’ensuit que nos dirigeants, issus en général de ce circuit d’élite, sont peu intéressés par l’université, quand ils ne la méprisent pas.
Notre université paie donc le prix d’une spécificité hexagonale ?
Ce partage universités/grandes écoles pèse très lourd. Partout ailleurs, le problème de l’université est vital puisqu’il y va de la formation des élites. Mais pas chez nous, la bourgeoisie française disposant d’un système ultra sélectif de grande qualité pour la formation de ses rejetons, qui a de surcroît l’avantage unique d’être gratuit. Mieux : on peut même y être payé pour apprendre - voir Polytechnique ou Normale Sup. L’université de masse, en regard, tend à être traitée comme un problème social. Nos gouvernants viennent de découvrir qu’elle était aussi un problème économique. Mais leur regard reste conditionné par le passé : ils veulent des résultats pour pas cher.
C’est sur un terrain déjà bien miné qu’arrive le mot nouveau d’« autonomie » ?
Ce mot admirable que personne ne peut récuser n’est qu’un mot. Il est illusoire de croire que parce qu’on a le mot, on a la chose. Demandons-nous ce qui se cache derrière ses promesses apparentes. Pour avoir une autonomie véritable, il faut disposer de ressources indépendantes. Or, en France, c’est exclu, puisque le bailleur de fonds reste l’État. On peut certes développer des sources de financement autres. Elles font peur à un certain nombre de mes collègues, mais je les rassure tout de suite, ça n’ira jamais très loin : le patronat français ne va pas par miracle se mettre à découvrir les beautés d’un financement qu’il n’a jamais pratiqué. Notre autonomie à la française ne sera donc qu’une autonomie de gestion à l’intérieur de la dépendance financière et du contrôle politique final qui va avec. Le changement est moins spectaculaire que le mot ne le suggère.
D’autres modèles étaient possibles ?
Certains pays de l’Est comme la Pologne ont pris un parti radical dans les années 1990. L’État a opéré une dotation des universités en capital et elles sont devenues des établissements indépendants. À elles de faire fructifier leurs moyens et de définir leur politique. Si un tel changement était exclu chez nous, ce n’est pas seulement en raison du « conservatisme » français. C’est aussi et surtout que notre système n’est pas si mauvais et que tout le monde le sait, peu ou prou. À côté de ses défauts manifestes, il possède des vertus cachées.
On pourrait même soutenir, de manière provocatrice, qu’il est l’un des plus compétitifs du monde, dans la mesure où il est l’un de ceux qui font le mieux avec le moins d’argent. C’est bien la définition de la compétitivité, non ? Dans beaucoup de disciplines, nous sommes loin d’être ridicules par rapport à nos collègues américains, avec des moyens dix fois moindres.
Et vous pensez que le grand public en a une vision déformée ?
Comment le connaîtrait-il ? L’image romantique du chercheur dissimule une réalité très différente. La recherche est probablement le secteur le plus compétitif, le plus concurrentiel, le plus soumis à la pression de tous les secteurs de la vie sociale. C’est d’ailleurs l’un des motifs de la désaffection pour les sciences. Il faut une vocation solidement chevillée au corps pour endurer cette vie de moine-soldat, où vous avez à vous battre tous les jours pour rester dans le coup, obtenir des moyens, faire valider vos résultats, le tout pour un salaire sans aucun rapport avec ceux des cadres de l’économie. Il y a quelque chose de fou dans le besoin d’en rajouter une couche et de resserrer encore le contrôle, comme si les chercheurs n’étaient pas capables de détecter seuls les sujets porteurs, comme s’ils étaient assez stupides pour aller s’embourber dans des domaines qui n’ont aucun intérêt pour personne.
Le pire à mes yeux pour l’avenir est dans cette prétention à programmer la recherche. Comme s’il pouvait exister des méta-chercheurs en position de piloter le travail des autres ! La situation normale est celle du chercheur qui soumet un projet à des instances qui le jugent réaliste, ou prioritaire, compte tenu des moyens disponibles, exactement comme un banquier prend un risque en prêtant de l’argent à une entreprise. Mais l’idée ne peut venir que du chercheur ! Autrement, le conformisme est garanti. C’est une machine à tuer l’originalité dans l’oeuf qui se met en place.
Quelles conséquences l’autonomie aura-t-elle sur la vie professionnelle des enseignants-chercheurs ?
L’autonomie entraîne le passage des enseignants-chercheurs sous la coupe de l’université où ils travaillent. L’établissement, à l’instar de n’importe quelle autre organisation ou entreprise, se voit doté d’une gestion de ses ressources humaines, avec des capacités de définition des carrières et, dans une certaine mesure, des rémunérations. C’est un changement fondamental, puisque d’un statut qui faisait de lui un agent indépendant du progrès de la connaissance, recruté par des procédures rigoureuses et évalué par ses pairs, il passe à celui d’employé de cet établissement.
Jusqu’où va ce « changement fondamental » ?
C’est un changement complet de métier. Il est visible que la mesure de cette transformation n’a pas été prise. L’autonomie des universités veut dire en pratique la mise au pas des universitaires. Toute la philosophie de la loi se ramène à la seule idée de la droite en matière d’éducation, qui est de créer des patrons de PME à tous les niveaux, de la maternelle à l’université. Il paraît que c’est le secret de l’efficacité. On peut juger que le statut antérieur était archaïque et n’était plus tenable à l’époque d’une université de masse, mais encore fallait-il expliciter les termes de cette mutation et clarifier les conséquences à en tirer.
Ce statut était un concentré de l’idée du service public à la française, avec ses équilibres subtils entre la méritocratie, l’émulation et l’égalité. Toutes les universités ne sont pas égales, personne ne l’ignore, mais tout le monde est traité de la même façon. Il n’y a rien de sacro-saint là-dedans, mais on ne peut toucher à tels produits de l’histoire qu’en pleine connaissance de cause et en mettant toutes les données sur la table.
C’est donc tout le fonctionnement de notre société qui est interrogé là ?
Le problème universitaire est un bon exemple du problème général posé à la société française, celui d’assurer l’adéquation à la marche du monde de notre modèle hérité de l’histoire et organisé autour de l’idée de République. Toute la difficulté est de faire évoluer ce modèle sans brader notre héritage dit républicain. Nous ne verserons pas d’un seul coup dans un modèle compétitif et privé qui n’a jamais été dans notre histoire. Comment intégrer davantage de décentralisation et d’initiative, tout en maintenant un État garant de l’intérêt général et de l’égalité des services ? C’est ce point d’équilibre entre les mutations nécessaires et la persistance de son identité historique que le pays recherche. Il n’est pas conservateur : il est réactif. Mais pour conduire ce genre d’évolutions, il faut procéder à découvert, oser le débat public.
Ce qui a été absolument évité...
Le gouvernement a fait le choix d’une offensive éclair, sur la base d’une grande méconnaissance du terrain universitaire. Probablement, ce sentiment d’urgence a-t-il été multiplié par le choc du classement mondial des universités fait par l’université de Shanghai, qui a secoué nos élites dirigeantes, sans leur inspirer, hélas, le souci de se mettre au courant. Si vous ajoutez à cela une image d’Épinal de ce qu’est le système universitaire américain, aussi typique du sarkozysme que largement fausse, plus l’idée que n’importe quelle stratégie de communication bien menée vient à bout de tous les problèmes, vous avez les principaux ingrédients de la crise actuelle.
Quelle sortie de crise imaginez-vous ?
Quelle que soit l’issue du mouvement, le problème de l’université ne sera pas réglé. Le pourrissement est (...) fatal, mais la question restera béante et resurgira. Si le gouvernement croit que parce qu’il a gagné une bataille, il a gagné la guerre, il se trompe. La conséquence la plus grave sera sans doute une détérioration supplémentaire de l’image de l’université, ce qui entraînera la fuite des étudiants qui ont le choix vers d’autres formes d’enseignement supérieur et ne laissera plus à l’université que les étudiants non sélectionnés ailleurs. De quoi rendre le problème encore un peu plus difficile.
Propos recueillis par Maryline Baumard et Marc Dupuis
http://www.lemonde.fr/societe/article/2009/04/22/marcel-gauchet-l-autonomie-veut-dire-la-mise-au-pas-des-universitaires_1183753_3224.html